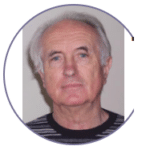« La
plupart du temps, tout se passe comme si de rien n’était, comme si la
question ne se posait pas ou que l’on ne savait pas la nommer, un peu comme
une sorte de lapsus ou de trou de mémoire, pour se soulager temporairement
du poids de l’histoire. Et puis, soudain, à l’occasion d’événements
politiques, d’élections, de crises économiques, sous l’effet de tensions
importées et de manifestations de violences réelles ou symboliques, la
question ethnique passe sur le devant de la scène, déborde, enflamme les
médias et l’opinion ». Dans l’éditorial de ce nouveau numéro de VEI
Enjeux consacré à « la discrimination ethnique, réalités et paradoxes », Marie
Raynal, situe bien l’irruption brutale de l’ethnicisation dans le débat
français. L’actualité immédiate, avec ses obsessions délirantes sur les
foulards, les turbans et les « pilosités », en témoigne avec suffisamment de
force. Elle justifie amplement ce numéro même s’il est douloureux pour
l’école d’aller gratter cette plaie. C’est que « les discriminations
ethniques n’épargnent pas l’école, même si là plus qu’ailleurs les stigmates
restent cachés ».
Cette affirmation, VEI Enjeux en démontre les fondements. Françoise Lorcerie
(Aix) analyse « l’effet outsider », c’est à dire le processus de mise à
l’écart, à l’école. Elle analyse les travaux les plus récents sur le sujet.
Ainsi le critère ethnique domine les mécanismes de contournement de la carte
scolaire et aggrave la polarisation ethnique des établissements. F. Lorcerie
cite les travaux de Jean-Pierre Zirotti et Daniel Zimmermann sur le jugement
professoral qui confirment l’importance des préjugés ethniques. De son coté,
Jean-Paul Payet a mis en lumière dans des collèges lyonnais leur rôle dans
les mécanismes d’orientation qui veulent que « les filles « françaises » et
les garçons maghrébins (soient) tendanciellement affectés les unes à la
division la plus valorisée, les autres aux divisions les moins prisées ».
Il nous livre, dans ce numéro, un bilan des travaux en cours depuis 1996,
depuis que le tabou de l’ethnicité a été levé : relation entre violence et
ethnicité, discriminations sexuelles, racisme entre élèves, racisme de
l’institution, ségrégation par l’école etc. Sur ce dernier point, les
recherches de Georges Felouzis, Françoise Liot, Joëlle Perroton (Bordeaux
II) sur la ségrégation ethnique dans les collèges de l’académie de Bordeaux
sont éclairants : la moitié des élèves d’origine maghrébine, africaine ou
turque sont regroupés dans 10% des collèges. Pour G. Félouzis, « c’est
sans doute (la) « massification » des stratégies d’évitement (des familles)
qui crée « en bout de course » les établissements fortement ségrégués ».
Le dernier mot dans ce numéro appartient à Jean Baubérot, président de
l’EPHE et titulaire de l’unique chaire de l’enseignement supérieur consacrée
à la laïcité. Analysant la situation, il craint « que nous ne soyons dans
une période de construction sociale d’ethnicisation ». A cela plusieurs
raisons, comme le rapport particulier de la République à l’universel. Elle
exige l’adhésion à ces valeurs mais impose en fait de se conformer aux
coutumes de la majorité. Face à ce défi, la loi n’est pas la bonne solution.
« Au citoyen d’agir » pour que vive vraiment la fraternité.
Ce numéro est le premier produit par la nouvelle rédaction. Dans un
entretien accordé au Café, Philippe Perrenoud recommandait aux enseignants
« de s’ouvrir davantage aux sciences sociales ». Nul doute que la
lecture du numéro 135 de VEI Enjeux leur soit profitable.
Le site VEI Enjeux
Entretien P. Perrenoud Café n°38