Quelques lectures pour pousser sa réflexion sur l’Ecole cet été…
Avec « Le plaisir d’apprendre », Philippe Meirieu nous donne un beau livre. Contre l’utilitarisme scolaire, il rappelle les exigences culturelles du métier et invite l’Ecole à chercher dans la culture les remèdes à l’ennui. Douze personnalités (F. Dubet, M. Gauchet, B. Cyrulnik, B. Stiegler etc.) appuient son propos et illustrent, parfois de façon saisissante comme Daniel Hameline, la pédagogie du chef d’oeuvre que défend P. Meirieu. C’est cette vibration, écho de la tension qui nait en classe quand le monde s’éclaire dans le regard des élèves, qui nourrit ce beau livre.
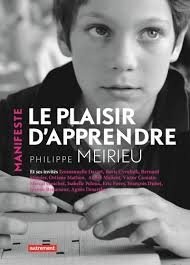
Il faut lire les pages où Philippe Meirieu explique ce qu’est le bonheur d’apprendre, « le seul événement qui fait grandir un être : quand il accède à la compréhension du monde. La connaissance , alors ne l’alourdit plus , elle l’allège. Autant dire qu’elle le libère ». C’est ce « face à face lumineux », cette flamme que l’enseignant lit dans le regard de son élève, qui motivent le professeur et alimente sa passion.
Mais pour Philippe Meirieu, cette passion est toute d’exigence. Il fustige « l’utilitarisme scolaire », la recherche de l’efficacité à tout prix et de l’utilité. « L’utilisation incantatoire et systématique du mot « compétence » dans les programmes scolaires signe l’incapacité de l’école à mobiliser les élèves sur de vrais enjeux culturels au profit des critères de la simple employabilité », écrit-il. A vouloir enseigner que ce qui rend employable, l’école est à coup sur perdante. « En cherchant systématiquement à l’extérieur des savoirs eux-mêmes les raisons de se mobiliser sur leur apprentissage, l’école se délite ». Contre l’ennui, P. Meirieu dresse la barrage du chef d’oeuvre. C’est le rôle du pédagogue que d’accompagner l’élève vers la construction de son projet, de son chef d’oeuvre qui à la fois intègre et émancipe. Pour P. Meirieu le plaisir d’apprendre est dans cette tension exigeante qui doit mener l’élève vers la culture et non vers les exercices routiniers.
A l’appui de sa thèse, P. Meirieu a fait appel à 12 auteurs, qui deviennent presque ses 12 apôtres. Qui mieux que André Malicot, directeur de la formation chez les Compagnons de France, peut défendre la place du chef d’oeuvre dans la formation d’un jeune ? Qui peut mieux que le sociologue François Dubet parler du bonheur à l’école, une question largement sous estimée par l’institution ? Il faut lire aussi le très beau texte de Daniel Hameline où il parle du partage d’une oeuvre musicale et de l’ouverture d’âme qu’elle apporte. Boris Cyrulnik, Berabrd Stiegler, Eric Favey, Emmanuelle Daviet, Jeanne Benameur, Isabelle Pelloux, Agnès Desarthe, Marcel Gauchet, Victor Caniato apportent aussi leur contribution à ce Plaisir d’apprendre.
Ce « Manifeste » de Philippe Meirieu est évidemment une réflexion sur l’enseignement. Mais c’est plus que cela. C’est un beau livre qui nous rappelle, les jours difficiles, la noblesse et la sincérité du métier d’enseignant. Merci Philippe Meirieu !
Philippe Meirieu, Manifeste. Le plaisir d’apprendre, Edition Autrement, ISBN 978-2-7467-3603-0
Meirieu : « Les valeurs de l’École et celles de la société s’éloignent de plus en plus. Un moyen de lutter contre ce divorce est de mettre la question du plaisir d’apprendre sur le tapis »
« Si nous ne voulons pas abandonner nos enfants à la sous-culture des « joueurs de flûte » qui les traitent essentiellement comme des « cœurs de cible », il faut bien se reposer la question du « plaisir d’apprendre » ». Philippe Meirieu explique ses choix pédagogiques et partage son inquiétude. « La bataille pour une école publique vraiment démocratique est loin d’être gagnée ».

Sans doute un peu tout cela. Mais, plus largement, nous assistons, je crois, à ce que Marcel Gauchet – que j’interroge dans le livre – nomme « l’inversion capitale de notre histoire culturelle récente » : que faire de savoirs qui « prennent la tête » dans une société qui aspire d’abord à « prendre son pied » ? C’est cela qui me frappe fortement aujourd’hui : même les méthodes prônées depuis l’Éducation nouvelle pour « donner du sens aux savoirs » – les « méthodes actives » ou la « pédagogie du projet » – tombent souvent à plat sur des élèves pour lesquels l’ « apprendre » n’est source que d’ennui, de difficultés, voire de souffrances. Certains, bien sûr, parviennent à trouver du plaisir dans tel ou tel exercice, telle ou telle discipline ; d’autres savent qu’il faut faire des sacrifices et que le plaisir est au bout du chemin, dans une réussite scolaire ou professionnelle future : c’est pourquoi ils concèdent des efforts, mais sans enthousiasme et en pensant que c’est un « mauvais moment nécessaire à passer ». Mais les premiers comme les seconds, de toute façon, ne sont pas équitablement répartis dans le champ social ! C’est une banalité de dire que la motivation pour la grammaire ou la biologie, pour Hésiode ou la loi de Joule n’est pas spontanément partagée par tous les enfants et les adolescents, indépendamment de leur origine sociale ou de leur histoire personnelle… Or, la chose est d’autant plus problématique qu’on cherche aujourd’hui à « refonder l’école », qu’on veut la « démocratiser », lutter contre les injustices sociales et contrecarrer les effets délétères de l’inflation publicitaire comme de la démagogie de certains médias. Si nous ne voulons pas abandonner nos enfants à la sous-culture des « joueurs de flûte » qui les traitent essentiellement comme des « cœurs de cible », il faut bien se reposer la question du « plaisir d’apprendre » et de la manière d’en faire un plaisir véritablement accessible et partagé.
Beaucoup d’enseignants se déclarent épuisés par l’exercice du métier. Souvent le métier réel leur apparait trop éloigné du métier voulu. D’autres fois, c’est les situations impossibles où les plongent les injonctions officielles. Quel regard jetez vous sur l’évolution du métier enseignant ?
Je comprends cet épuisement et, au-delà des situations matérielles particulièrement difficiles vécues par certains d’entre eux, il me semble précisément lié à cet enjeu proprement anthropologique du statut de « l’apprendre » et de l’accès à la culture dans notre société. Comment ne pas être épuisé quand on a le sentiment que toute transmission se heurte à une forme de délégitimation a priori ou, au mieux, de relativisation condescendante ? Comment ne pas être affecté – au sens fort de ce mot – quand des connaissances, des biens culturels, des œuvres que l’on considère comme des expressions essentielles de « l’humaine condition », dans ce qu’elle a de plus exigeant et exaltant à la fois, ne mobilisent guère des élèves pour lesquels « la vraie vie est ailleurs » ou qui ne cèdent à nos injonctions qu’en considérant tout cela sous l’angle exclusif de son « employabilité » immédiate ou future ? Comment ne pas être découragé quand on ne parvient pas à transmettre cette vibration particulière des savoirs dont on est porteur, ce plaisir d’apprendre et cette joie de comprendre qui nous ont fait nous engager dans ce métier et qui semblent hors de portée de la majorité de ceux et celles dont on est chargé ? C’est tout cela que j’aborde dans le livre et à quoi je tente d’apporter, sinon des solutions, du moins des perspectives qui permettent d’espérer.
Précisément, vous dites que la transmission du plaisir d’apprendre est liée au fait de ressentir le plaisir d’enseigner. Mais n’est-ce pas un cercle vicieux, alors ? Quelles mesures prendre pour développer le plaisir d’enseigner ?
Pour moi, le plaisir d’enseigner est profondément indissociable de la posture que l’on a à l’égard de ses propres savoirs : si l’on se place dans un posture de simple « détenteur-transmetteur », on risque de ne rien engrener dans sa classe et de ne guère mobiliser ses élèves. En revanche, si l’on se place dans une posture d’ « explorateur-créateur » de ses propres savoirs et des moyens de les transmettre, alors on peut enclencher une dynamique particulièrement féconde. C’est pourquoi, je crois que la formation initiale et continue doit permettre aux enseignants de réinvestir sans cesse cette posture, de chercher ensemble comment on peut donner prise sur les savoirs, mobiliser l’intelligence sur des connaissances, réussir à faire fonctionner des situations d’apprentissage pour que le cerveau des élèves se mette à pétiller et qu’ils découvrent – même fugitivement – que l’école n’est pas seulement le lieu de contraintes arbitraires mais aussi le lieu de découvertes qui donnent vraiment du plaisir. Il suffit, sans doute, pour un élève d’avoir entrevu cela, d’avoir rencontré un adulte qui en témoigne, d’avoir réussi lui-même à éprouver la joie d’expliquer ce qu’il a compris, pour que son destin scolaire puisse en être changé… Et vous comprenez bien que je plaide ici pour une révolution copernicienne en matière de formation des enseignants : pour qu’ils éprouvent et transmettent le plaisir d’apprendre, je crois qu’il leur faut une véritable formation pédagogique, qui leur fait cruellement défaut.
Vous défendez le chef d’œuvre et l’effort de l’élève dans le plaisir de l’école. Effort et plaisir, n’est ce pas contradictoire ?
Je critique vivement cette pédagogie laxiste qui consiste à noter successivement des exercices ou des devoirs médiocres sans jamais permettre à un élève de pouvoir s’améliorer pour accéder jusqu’à ce qui pourra représenter, pour lui, un niveau de perfection. Je crois que le plaisir s’éprouve dans le travail pour se dépasser, dans la réalisation d’une œuvre dont on peut être fier, quand on a vraiment compris quelque chose, qu’on s’est approprié des connaissances et qu’on a pu les ressaisir dans un « chef d’œuvre » qui en est, tout à la fois, la miniaturisation et la conceptualisation. Là l’intention et la réalisation se conjuguent, comme l’effort et le plaisir… Je tente d’expliquer, dans le livre, comment s’opère ce processus et comment il peut fonctionner pour l’élève de maternelle à qui l’on apprend à dessiner comme pour l’élève de terminale qui fait une dissertation de philosophie, pour l’élève de collège qui étudie les vallées glaciaires comme pour l’étudiant d’université qui rédige un mémoire. Le chef d’œuvre n’est pas réservé à « l’élite », tout au contraire : il doit être possible à tous les niveaux taxonomiques. C’est de le considérer comme un « aboutissement » réservé à quelques-uns, après une enfilade d’exercices médiocres, qui crée artificiellement des « élites ». En réservant l’excellence au soi-disant « couronnement » des études, on condamne toute une série d’élèves à la médiocrité et, finalement, à l’échec.
On sait que le métier d’enseignant est difficile et peu payé. Pourtant de nombreux salariés font ce choix et quittent des carrières souvent bien parties. Vous en avez connus et aidés de nombreux à l’IUFM de Lyon. Qu’est-ce qui les motive ? Serait-ce le plaisir d’apprendre et d’enseigner ?
Oui, je le crois, au moins pour une part. C’est pourquoi je suis absolument convaincu qu’il faut encourager, par tous les moyens, ces reconversions qui viennent enrichir de manière particulièrement précieuse le corps enseignant. En se recentrant sur le désir de transmettre leur propre plaisir d’apprendre, ces nouveaux enseignants « venus d’ailleurs » nous disent des choses essentielles sur le métier. Il faut les entendre nous expliquer ce que représente la possibilité de ne plus être tenaillés en permanence par des exigences de rentabilité immédiate, la joie qu’il y a à prendre le temps d’examiner les choses pour comprendre vraiment « comment ça marche » et pas seulement « comment satisfaire aux impératifs de la production ». Il faut les voir accéder avec bonheur à cette posture de « chercheur-créateur », portés par le désir de transmettre, non pas seulement des résultats, mais une démarche, une impulsion, un engagement. Il faut les entendre dire leur plaisir à pouvoir être, au quotidien, au plus près de l’exigence de précision, de justesse, de rigueur, de vérité… Au point que j’en viens à me demander si dans la « société de la connaissance » qu’on nous annonce, il ne serait pas possible, utile, indispensable même… que chacune et chacun, quel que soit son métier et sa fonction, puisse disposer d’un temps pour desserrer les mâchoires de l’efficacité immédiate, réinterroger les savoirs qu’il utilise avec les yeux d’un apprenant et les transmettre à d’autres ! Sans nier la spécificité du métier d’enseignant, on pourrait imaginer, dans le cadre d’un meilleur partage du temps de travail, de dégager du temps pour tout le monde afin de mettre la transmission des savoirs au cœur de notre société, dans la perspective de cette « économie contributive » que Bernard Stiegler appelle de ses vœux dans le livre.
L’ouvrage est enrichi de contributions d’auteurs connus ou moins connus, écrivains, sociologues, artistes et une seule enseignante. Certains ont parfois la dent dure avec l’institution scolaire, voire les enseignants. Qu’est ce qui motive leur participation et votre choix ?
J’assume tout à fait ce choix. Car, même si la plupart des contributeurs ont été longtemps enseignants (et le sont encore d’une manière ou d’une autre), j’ai voulu qu’ils puissent se situer de manière un peu décentrée par rapport aux approches souvent trop didactiques de cette question. J’avais envie que les enseignants puissent entendre, sur une question qui est au cœur de leur métier, les points de vue d’une romancière et d’un sculpteur, d’un pédopsychiatre et d’un sociologue, d’un philosophe et d’un formateur d’adultes… Je ne crois pas qu’ils aient la dent dure avec les enseignants. Ils reconnaissent l’extraordinaire difficulté de leur tâche et tentent de comprendre pourquoi il en est ainsi. Ils disent aussi, avec leurs mots, ce que les enseignants n’osent pas toujours dire… parce que ce n’est pas « institutionnellement correct », parce que ce n’est pas « prouvé par les neurosciences » ou parce que ce n’est pas « dans les instructions officielles »… Ils évoquent des dimensions de « l’apprendre » qui relèvent souvent de l’impensé, qui échappent à nos discours formatés… Au total, je crois qu’ils donnent une belle idée de ce qu’est « le plaisir d’apprendre » et la « mission d’enseigner » : ils rendent ainsi un superbe hommage aux enseignants !
Aujourd’hui, l’Ecole vous semble-t-elle menacée et en panne ou en train de se reconstruire ?
J’aimerais être sûr qu’elle est en train de se reconstruire. Mais je reste inquiet. Inquiet politiquement, car la bataille pour une école publique vraiment démocratique est loin d’être gagnée. Inquiet institutionnellement, car je ne vois pas les modes de « gouvernance » – comme on dit aujourd’hui – évoluer sensiblement vers plus de coopération pour créer de véritables dynamiques collectives. Inquiet pédagogiquement, car j’ai le sentiment que la pédagogie reste – malgré la volonté du ministre – assez marginale dans la formation des enseignants et des cadres éducatifs, comme dans le pilotage du système. Inquiet sociologiquement aussi, car je mesure l’écart qui se creuse de plus en plus entre le monde de l’École et le fonctionnement sociétal dans son ensemble : les valeurs de l’École et celles de la société s’éloignent de plus en plus ! Un moyen de lutter contre ce divorce est de mettre, précisément, la question du plaisir d’apprendre sur le tapis. Même si cette question paraît farfelue à certains. Car, aucune réforme, aucun changement de programme, aucun « comité Théodule » supplémentaire ne pourra contribuer à faire advenir l’École dont notre démocratie a besoin si la question du plaisir d’apprendre ne devient pas un enjeu collectif fondateur.
Propos recueillis par François Jarraud
Appuyé sur une vaste enquête à la fois qualitative et quantitative, le sociologue Pierre Périer observe les observations en profondeur du métier d’enseignant. Face à l’incertitude pédagogique, les nouveaux professeurs se sont forgés un métier individualisé et pragmatique, bien éloigné du modèle de la vocation.
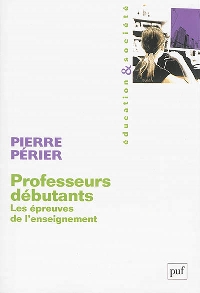
Cette situation fabrique de nouveaux enseignants différents de leurs ainés, estime P Périer. « La spécificité des nouveaux enseignants pourrait consister dans uen conscience assez aiguë des aspects relationnels du métier », écrit-il. Ils fabriquent leur métier et leurs relations avec les élèves alors que celles-ci étaient nettement plus conventionnelles. Leur entrée dans le métier relève plus d ‘un choix rationnel que d’une vocation. Leur maintien est un combat renouvelé sans cesse. Leur devenir dans l’enseignement est tout sauf assuré.
L’ouvrage de Pierre Périer nous donne donc les clés des vraies évolutions du métier. Pas le corps statutaire et gravé dans le marbre. Pas la carrière gérée par l’avancement au mérite ou à l’ancienneté. Mais le métier observé au contact du réel. Sous a croute des définitions immuables, le métier est en train de changer sous nos yeux. Pierre Périer nous permet de le voir.
Pierre Périer, Professeurs débutants. Les épreuves dans l’enseignement, PUF, ISBN 978-2-13-060943-8
Pierre Périer : « On est passé d’un métier de la transmission à un métier de gestion des relations »
Qui sont-les jeunes profs ? Sont-ils tous sur le même modèle ? Comment vont-ils vieillir ? Pierre Périer revient sur les principaux enseignements de son livre. Et il met en garde : « Le risque c’est l’épuisement plus précoce ».
Qui sont ces jeunes enseignants ? Comment entre-t-on dans le métier ? Qu’est-ce qui peut pousser des personnes à y entrer alors que les médias ne le présentent pas positivement comme le confirme le dernier sondage Se-Unsa ?

Ne peut on pas trouver des types de parcours différents selon les disciplines ?
Il y a deux grandes familles. D’un coté, les littéraires avec les lettres et les langues. De l’autre, les sciences. Dans la crise du recrutement on voit bien que c’est très tendu du coté scientifique. En lettre, histoire et langues ça reste un débouché majeur et qui assure le lien avec la discipline. D’autres cherchent la dimension éducative du contact avec les jeunes. Dans les disciplines scientifiques, la discipline est moins privilégiée. C’est le métier qui intéresse.
Peut on parler d’in ou de plusieurs métiers d’enseignant ?
Il y a bien plusieurs métiers. Par exemple celui qui est exercé en zep est différent des établissements hors zep. Il y a de fortes variations selon les situations. Elles sont plus fortes qu’avant. Surtout, l’enseignant se construit lui-même son métier.
L’origine sociale, généralement assez privilégiée, des enseignants est-elle aujourd’hui un avantage ou un handicap pour enseigner ?
L’enseignant est aujourd’hui plus défini par ses pratiques que par sa personne. Il y a dans ce métier une dimension personnelle très grande. On observe que les enseignants débutants se coulent plus difficilement dans le moule. Ils se mettent plus en danger. On observe aussi que la distance sociale et culturelle entre eux et les élèves est plus grande pour les enseignants débutants car ils sont plus souvent en zone prioritaire que les autres enseignants. Mais un autre déterminant est plus important : c’est leur passé scolaire : ce sont d’anciens bons élèves. On a de bons élèves face à des élèves en difficulté. Ils sont donc dans des représentations du métier alimentées par les élèves qu’ils ont été, ces fameux élèves écrans dont parle Rochex. Ca les éloigne des élèves et de leurs familles.
Peut-on parler d’une nouvelle professionnalité enseignante ?
Dans un certain sens, oui. Sur le plan des postures et des compétences. Ils sont conscients que le métier est à construire, qu’il n’est pas donné. Et que cette construction leur incombe. D’où leur réflexivité.
Ils ont une meilleure connaissance des élèves, des conditions d’exercice. Ils ont des compétences pour poser une autorité, gérer des relations avec les élèves. On est passé d’un métier de la transmission à un métier de gestion des relations. Les savoirs sont toujours là mais ils passent par une gestion plus complexe des relations avec les élèves. C’est d’ailleurs ça qui achoppe parfois. Ce qui est déterminant c’est l’autorité qu’on peut établir et faire accepter. J’insiste dans le livre sur l’autorité car elle occupe beaucoup les enseignants. Ils ont acquis des compétences en ce domaine. Ils savent qu’elle n’est pas acquise. J’essaie de montrer qu’il n’y a plus de légitimité par l’institution ou les savoirs. Les enseignants doivent négocier l’autorité avec les élèves et ce n’est pas simple. Ils ont des élèves moins disposés à se soumettre a des rapports maitre élève car la dissymétrie est plus interrogée. Il y a toute une réflexion sur l’autorité, la sanction, l’enjeu de ne pas rester isolé.
Un aspect intéressant du livre c’est que vous donnez des données sur les réactions des enseignants selon leur âge. Comment ça vieillit un professeur ?
On verra comment cette nouvelle génération vieillira. Je pense qu’un des ressorts qui peut nous permettre d’être optimiste c’est sa capacité de réflexivité. Il y a un déficit d’accompagnement des enseignants. Mais ils peuvent s’appuyer sur leur compétence à s’adapter. Le métier est plus exigeant. Il est vécu de manière plus professionnelle et en même temps plus personnelle. Il est plus engagé. Le risque c’est l’épuisement plus précoce. Je me demande si on ne le constate pas déjà. C’est difficile d’imaginer faire ce métier durant des dizaines d’années. Il y a une telle exigence de renouvellement et d’engagement que c’est beaucoup demander à des enseignants. Comment leur offrir des alternatives après des années d’exercice ? On voit déjà l’épuisement dans l’éducation prioritaire.
Quand je vous écoute j’ai l’impression qu’il ne faut pas revoir la formation des enseignants. Est-elle suffisante ?
Elle est nécessaire mais pas suffisante. La formation ne pourra jamais anticiper la diversité des situations. L’expérience est plus riche que la formation. Donc c’est à la fois une posture et un outillage intellectuel qui sont donnés. Après il faut davantage penser l’accompagnement des enseignants débutants. C’est devant les élèves qu’ils se rendent compte que le cours sur la psychologie de l’adolescent qui ne les avait pas intéressé il y a 3 ans était nécessaire. C’est la temporalité de la formation qu’il faut ajuster à celle de l’action.
Propos recueillis par François Jarraud
Peut-on vraiment modifier les croyances des futurs enseignants ? On voit tout de suite l’intérêt de cette question au moment où on rétablit une formation professionnelle des enseignants avec la volonté de ne pas reproduire de génération en génération la même école mais de la changer. Marcel Crahay et Fanny Boraita, université de Genève, se sont attachés à compulser toutes les études sur ce sujet pour arriver à définir les bonnes stratégies de changement et donc, finalement, de formation des enseignants. Ils nous offrent dans la Revue française de pédagogie, n°183, une véritable réflexion sur la formation des professeurs.

Marcel Crahay et Fanny Boraita étudient dans la littérature pédagogique existante, les effets des programmes de formation. En commençant par la question des cours théoriques : sont-ils susceptibles de faire évoluer les représentations des futurs enseignants ? La conclusion est sans appel. Le fossé est tel entre théorie et réalité de l’enseignement que les futurs profs la dénoncent. Elle n’influe pas sur leurs croyances.
Les programmes de formation ont-ils plus de chance ? Marcel Crahay lui même a mené une enquête auprès de 650 futurs profs sur leur représentation du redoublement. Au début de la formation ils sont généralement favorable à cette pratique. En fin de formation c’est nettement plus mitigé et leur opinion a tendance à se caler sur celle du formateur. Mais ils restent incapables de la justifier ce qui signe une grande fragilité.
La formation pratique fera-t-elle mieux ? Les résultats sont à la fois positifs et négatifs. Des études montrent que les futurs enseignants voient évoluer leurs représentations. Mais au fur et à mesure du déroulé du stage ils accordent une importance croissante à la gestion de la classe. En clair ils s’éloignent des conceptions socioconstructivistes apprises en formation.

Quels enseignements retenir ? M Crahay et F Boraita font apparaitre des pistes pour permettre le changement. La formation doit favoriser une démarche auto réflexive. Celle-ci ne va pas de soi. Il faut donc susciter « des dissonances cognitives » chez les futurs enseignants. En conséquence il faut favoriser l’expression des futurs enseignants. Il faut les confronter à des cas d’enseignement. Et enfin privilégier l’enseignement de connaissances procédurales. Au final, devenir un enseignant c’es bien faire un travail sur soi, rappellent les auteurs.
François Jarraud
F Boraita et Marcel Crahay, Les croyances des futurs enseignants, Revue française de pédagogie n°183, 2013.
|
||
|
|




