« Résister, c’est, quand il y a lieu, continuer à préserver ce que j’appelle la « transmission d’humanité », pour que la relation professionnelle ne se transforme pas en une relation destructrice, autant du professionnel que de celles et ceux qui reçoivent son enseignement ou sa formation. Une résistance de pensée, pour conserver la responsabilité de nos actes ». Dans son nouvel ouvrage, » S’engager pour accompagner » PUF, Mireille Cifali, professeure honoraire de l’université de Genève, analyse l’engagement du formateur dans la transmission. Dans cet entretien, réalisé par Bruno Robbes, elle revient sur les engagements de ce nouveau livre.
Bruno Robbes – Vos travaux dans le champ de la formation s’ancrent dans une approche clinique. Pouvez-vous définir ce que vous entendez par approche ou démarche clinique en éducation et en formation ?
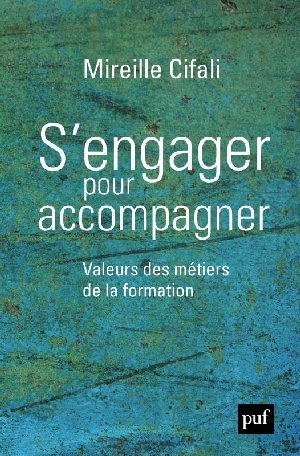
Entendons-nous bien, être formateur c’est devoir se centrer sur une technique, une théorie, une discipline, une science particulière, ce qui exige une connaissance approfondie des savoirs qui leur sont liés et dont nous avons été reconnus en tant qu’« expert ». Ce qui m’intéresse, c’est en quelque sorte le surcroît : comment ce savoir se transmet-il étant donné que toute transmission est relationnelle, que se soit entre un formateur et des étudiants déjà professionnels ou non, entre un enseignant et des élèves ?
D’autres éléments interviennent en effet tels que notre présence corporelle, notre manière de nous adresser à l’autre, la façon dont nous nous rapportons à notre savoir, notre relation à la découverte toujours à espérer, à notre enthousiasme à transmettre, notre intérêt pour les difficultés rencontrées par les étudiants… Il s’agit, d’une part, d’une attention à la dimension relationnelle qu’elle soit relative à un groupe, aux personnes qui composent ce groupe, aux réactions singulières et, d’autre part, d’une attention à soi pour comprendre ce qui parfois est pris de soi dans nos gestes professionnels.
Être donc sensibles également à la dimension de l’affect, des sentiments éprouvés, comme la peur, l’angoisse mais aussi la joie, et au lieu de ne pas en tenir compte, les mettre au travail pour comprendre ce qu’ils nous signifient, en quoi ils favorisent la transmission ou la rendent difficile d’accès pour un autre.
Précisons cependant qu’une démarche « clinique » n’est pas à confondre avec une démarche thérapeutique qui serait liée au médical. Ma démarche s’est construite à partir de références multiples, autant psychanalytiques, philosophiques, psychosociologiques, littéraires. Il s’agit ici de travailler dans la singularité des situations, d’être attentifs aux efficiences de l’altérité.
BR – Pouvez-vous dire également en quoi cette approche vous paraît indispensable aux formateurs et aux enseignants d’aujourd’hui ?
MC – Elle l’est, et le demeurera malgré des accents mis sur d’autres approches scientifiques. Elle est qualitative, cherche à permettre qu’un geste professionnel de formation ou d’enseignement soit au plus juste, pour soi et pour un autre. Sa présence même interroge une façon souvent actuelle de définir « la qualité » par une codification des pratiques, par l’importance donnée aux statistiques et aux seules procédures dites rationnelles. La qualité dépend ici d’une intelligence de la relation, de la capacité d’un professionnel de penser ses gestes avec d’autres, de partager ses difficultés.
Y a-t-il des formateurs qui devraient être les « spécialistes » de ce surcroît ? S’il y en a, ils ont tendance à se raréfier, et c’est dommage. C’est alors à chaque formateur, à chaque enseignant, à chaque éducateur de prendre soin de cette dimension, de la faire exister à même sa discipline. C’est une manière, il y en a d’autres, de préserver dans toute formation, même la plus technique, une « transmission d’humanité », un regard bienveillant posé sur l’autre, une écoute ouverte pour qu’il puisse traverser les difficultés inhérentes à un apprentissage.
BR – L’ouvrage que vous publiez en cette rentrée investigue la notion d’engagement dans l’accompagnement des formés. Votre conception de l’engagement est-elle conciliable avec le sentiment de nombreux enseignants et éducateurs d’être « sur-engagés » dans leur métier, parfois au risque du burn-out ? Pourriez-vous expliquer comment vous concevez engagement et éthique ?
MC – Oui vous avez raison, il est nécessaire d’apporter de la nuance à ma manière d’envisager l’engagement. Il s’agit ici d’un engagement sensible, c’est-à-dire permettant de demeurer « présent » dans nos actes de formation, mais aussi d’éducation et d’enseignement. Donc un engagement corporel, de regards, de voix, je le concrétise par le mot « présence » que je tente de cerner, de ne pas laisser dans le flou.
C’est tout autre chose que l’agitation, la multiplicité des tâches que l’on donne aujourd’hui aux professionnels, avec un administratif envahissant, en ne leur reconnaissant pas la nécessité d’espaces pour penser, pour sortir de l’attendu quand des difficultés – ou même pas – apparaissent. Se maintenir en recherche avec d’autres est un antidote au burn-out. Ne pas réduire les difficultés rencontrées à des affaires personnelles, et chercher à ne pas tomber dans l’impuissance quand les causes semblent être hors de portée. J’ai différencié « engagement » d’investissement : « Engagement d’être, engagement dans la rencontre, engagement vis-à-vis de soi-même, engagement vis-à-vis d’un autre. Être concerné par ce qui arrive, accueillir et chercher à continuer l’échange. Ne pas se dérober, prendre des risques, se maintenir dans un processus de création… »
Lorsque que vous n’avez pas d’espace psychique et physique pour penser, pour réfléchir, pour comprendre les effets de certaines injonctions institutionnelles, parfois même contradictoires, lorsque vous êtes pressurisés par un administratif censé contrôler vos actes et qui vous prend bien trop de votre temps, lorsque vous n’avez pas d’appui, pas d’accompagnement pour comprendre les événements parfois violents que les situations professionnelles peuvent comporter, alors les risques pour soi sont grands. Là, le professionnel et le personnel se confondent et deviennent difficiles à démêler.
BR – Dans vos pratiques d’accompagnement, comment articulez-vous théories et pratiques ? Pour quelles finalités ?
MC – Peut-être pouvons-nous, avant que je ne vous réponde, revenir à la question de l’accompagnement. C’est un mot qui aujourd’hui, on pourrait dire, est à la mode. J’ai eu l’occasion d’y réfléchir il y a très longtemps. Effectivement, « accompagner » comporte des aspects très intéressants, mais aussi des dérives et on assiste à des mésusages de ce mot.
Cet ouvrage en témoigne dans la plupart de ses chapitres : comment accompagnons-nous dans la construction d’un savoir de l’expérience ? Comment accompagnons-nous quelqu’un – que ce soit un élève, un étudiant – dans ses difficultés ? Comment respectons-nous son cheminement tout en acceptant aussi de tenir une position d’autorité, de bousculer parfois ? Comment mettons-nous à l’œuvre une croyance « efficace » : croire dans les potentialités d’un autre malgré un présent qui lui est très difficile ?
Accompagner, c’est permettre à un autre de comprendre. Ce n’est pas être intelligent à sa place, c’est le rendre intelligent. C’est lui fournir des éléments qu’il pourra s’approprier, espérons-le, pour progresser dans ses apprentissages normaux, ou lors d’une difficulté particulière. Dans cette pratique là, que l’on retrouve dans ce qui est nommé aujourd’hui « analyses de pratique », notre rapport au savoir est peut-être un peu différent que lorsqu’on instruit uniquement à partir de disciplines scientifiques. Qu’est-ce que j’entends par là ? Un formateur a besoin d’avoir construit pour lui-même un savoir vivant en lien avec des pratiques professionnelles, ou si on parle d’un enseignant, les savoirs d’une discipline. L’enjeu reste qu’un autre puisse se les approprier à son tour. Ce n’est pas vouloir qu’il reconstruise les connaissances qui ont déjà été élaborées par une démarche scientifique, mais qu’il recherche une compréhension de ce qui se passe dans une pratique professionnelle toujours singulière et qui dépasse invariablement les attendus d’une seule discipline scientifique.
Mon domaine est de rendre sensibles les formateurs, les enseignants, aux dimensions affectives et relationnelles de toute situation d’apprentissage. Il s’agit pour moi non pas forcément d’expliquer, mais de partager ou de favoriser une compréhension, de guider non seulement à partir de mes connaissances théoriques, mais aussi des connaissances qu’un professionnel a de son terrain particulier, pour que ce dernier puisse trouver des dégagements, d’autres voies à explorer. Lui seul peut le faire, c’est là le bénéfice de son engagement dans une situation. C’est donc un usage du savoir qui priorise la construction d’une intelligence des situations par un professionnel, et qui évite au formateur d’être l’unique qui sait, envahissant par son savoir la pensée d’un autre, parfois même l’interdisant.
BR – À plusieurs reprises dans votre livre, vous militez pour que les formateurs, les enseignants, sachent résister. Qu’est-ce qui, actuellement, vous semble le plus menacer ces métiers, qui justifierait que les professionnels adoptent des postures de résistance ?
MC – Là encore il s’agit de préciser l’usage des mots. On a souvent parlé par exemple de la résistance des enseignants à la transformation de leurs pratiques. Sont jugés négativement les enseignants qui pensent que certaines nouvelles pratiques proposées ne sont pas aussi favorables que l’on prétend, surtout lorsqu’elles ne tiennent pas compte de leur expérience, en font table rase, dévalorisent les pratiques dites anciennes (donc dites dépassées). La résistance est prise comme négative et l’on en reporte la responsabilité sur les enseignants qui ne veulent pas évoluer… Alors que la résistance est en partie fabriquée par la manière dont on s’adresse à eux.
Quand je parle de résistance dans mon ouvrage, c’est une résistance positive, pensée. Elle n’est pas réaction négative à toute nouveauté. Peut-être devrais-je plutôt parler en terme de « persistance » c’est-à-dire de « sauvegarde », dans les actes professionnels, de cette dimension humaines de la relation, du « juste » rapport à l’autre et à soi, d’une dynamique de création commune, de joie à partager un savoir malgré des conditions institutionnelles qui peuvent aller jusqu’à empêcher ces processus de création au nom d’une normativité, de processus standard, ou d’une manière unilatérale d’estimer qu’à partir d’une seule théorie, on peut résoudre les problèmes de l’apprentissage.
Résister, c’est donc, quand il y a lieu, continuer à préserver ce que j’appelle la « transmission d’humanité », pour que la relation professionnelle ne se transforme pas en une relation destructrice, autant du professionnel que de celles et ceux qui reçoivent son enseignement ou sa formation. Une résistance de pensée, pour conserver la responsabilité de nos actes, pour préserver tout le savoir de l’expérience qu’un professionnel se donne souvent la peine de construire et qu’un théoricien ne peut pas réduire à sa seule dimension théorique.
Je ne sais pas si j’arrive là à mieux m’exprimer. Il y a à la fois un double discours : celui d’avoir des professionnels de haut niveau et celui où l’on interdit à ces mêmes professionnels de penser par eux-mêmes. Du moins, on ne leur donne pas les espaces pour penser leurs pratiques avec d’autres, pour les aménager, pour se confronter à la singularité de leur situation dans telle ou telle région, tel ou tel collège, telle ou telle école, tel ou tel lieu de formation. On sait bien que quand des enseignants ont ces espaces pour créer ensemble, cela donne une dynamique qui permet aux élèves d’être pris eux-mêmes dans ce mouvement. C’est ainsi qu’on résout parfois certains problèmes de violence, de désertion, de refus, de déni dans lesquels peuvent être pris certains élèves, certains formés. Tout l’apport de la pédagogie institutionnelle et d’autres mouvements pédagogiques ne devrait pas être perdu. Encore s’agit-il que les enseignants ne s’enferment pas dans leur quant-à-soi et leur suffisance à tout savoir, mais se mettent dans la position d’apprendre à leur tour de leurs collègues ou formateurs.
BR – Vous évoquez l’engagement dans la transmission des savoirs en relation avec la joie, voire le surcroît d’être, que procurent la pensée et la formation. Pouvez-vous définir ce que vous entendez alors par « savoirs » et comment, aujourd’hui, redonner aux formés cette joie et ce surcroît d’être par les savoirs ?
MC – Dans l’ouvrage, je relate, je décris, j’ai essayé d’écrire ce qu’ont été mes essentiels, dans mon rapport à la recherche de comprendre. Il s’agit d’une quête de savoir, mais aussi d’une quête psychique. Penser peut être une joie, même s’il y faut de l’exigence, de l’effort, que nous ne sommes pas épargnés par la difficulté. Penser, surtout, est ce qui nous maintient vivants. Quête de l’énigme ; il y a de l’énigme toujours et encore dans les actes éducatifs et formatifs : comment on grandit, comme on apprend, comment on se situe dans le monde, comment on module nos relations, comment on aime, comment on se détruit, comment on n’y arrive pas. Une quête qui cherche parfois péniblement à se dégager de nos croyances préalables, souvent influencées par les normativités d’une société.
Dans les métiers de la relation, les métiers de la formation, nous avons besoin d’être continuellement en recherche, si nous voulons nous préserver et préserver celles et ceux qui sont en face de nous de certaines dérives contenant de la destructivité. Comment rendre un savoir joyeux malgré les contraintes, les exercices, les répétitions, les échecs, les erreurs, les difficultés à réussir en une seule fois ? C’est ce mouvement vers une recherche de sens que l’adulte peut partager. S’il y arrive, c’est le plus précieux pour celle ou celui qui peut le recevoir. Et c’est à préserver à tous les niveaux, pour un universitaire comme pour un professionnel dans un métier dit-manuel, cette intelligence des actes, des gestes, des paroles face à une réalité qui nous bouscule. Ce n’est pas une question de hiérarchie intellectuelle, c’est une question primordiale pour chacun de nous, quant à notre vie, à notre éthique.
BR – Ce livre est le premier d’une trilogie. De quoi traiterez-vous dans les deux prochains livres ?
MC – Oui j’espère que les deux autres ouvrages trouveront à se publier. L’un revient, pour les métiers de la relation (formation, enseignement, soin, éducation, accompagnement), sur mes fidélités. Il s’aventure à préciser les modalités d’une éthique de la relation, celles d’un travail d’intériorité et celles des sentiments éprouvés. Il renoue avec un humanisme exigeant, et préserve – c’est le mot qui insiste – une énigme lorsqu’il s’agit de nommer l’écart à maintenir avec une vision matérialiste de l’humain et du monde. Il se nomme pour l’instant « Préserver une intériorité. Éthique des métiers de la relation ».
L’autre questionne le travail de transmission pour y affirmer la nécessaire préservation – là encore – d’une subjectivité engagée dans ses gestes et ses paroles, d’une « subjectivité travaillée », qui fait présence à soi, aux autres et au monde. Bien loin d’une centration psychologique sur le moi et son intimité. Y sont évoqués une responsabilité clinique vis-à-vis des enseignants, et une responsabilité des enseignants vis-à-vis de celles et ceux qu’ils rencontrent. L’accent y est mis sur les dynamiques de la reconnaissance. Il se nomme pour l’instant « S’éprouver en présence. Responsabilités de l’enseignement ».
Propos recueillis par Bruno Robbes
Mireille Cifali, S’engager pour accompagner. Valeurs des métiers de la formation. PUF 2018. ISBN 978-2-13-081036-0




