Rémi Brissiaud (laboratoire Paragraphe – Université Paris 8) intervient dans le débat des futurs programmes pour l’école primaire, pour réagir aux analyses des chercheurs spécialistes de l’enseignement des mathématiques à l’école primaire, dans le café le 10 juin (http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/06/1[…]). Pour lui, l’évolution des acquis en mathématiques sur les dernières décennies, pose en effet problème : les programmes de 2002 semblent responsables d’une réelle baisse du niveau.
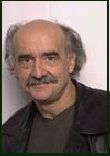
Tardivement, ils viennent de prendre la parole dans un texte paru sur le Café Pédagogique le 10 juin dernier[i]. Les auteurs de ce texte sont quatre didacticiens des mathématiques, Marie-Hélène Salin, Marie-Lise Peltier, Joël Briand et Roland Charnay. Trois autres maîtres de conférences de didactique des mathématiques l’ont cosigné sans avoir participé à sa rédaction. Or, tous ces chercheurs ont été soit responsables, soit associés au processus d’élaboration des programmes de 2002 et, en tout cas, ils les ont fortement défendus par le passé. Leur expérience commune remonte même plus loin car ils ont tous peu ou prou été associés à ce qu’on peut considérer comme un tournant didactique pour l’école française : la réhabilitation de l’enseignement du comptage-numérotage en 1986.
Il faut évidemment se réjouir que les initiateurs de ce tournant didactique s’expriment aujourd’hui. En effet, une étude de Thierry Rocher[ii] a montré que les performances en calcul des élèves de CM2 se sont effondrées entre 1987 et 1999 et, depuis près de cinq ans qu’est parue cette étude, le silence de ces chercheurs sur ce phénomène, était assourdissant. Rappelons que Thierry Rocher a montré qu’entre 1987 et 1999 la moyenne générale des élèves de CM2 à une épreuve de calculs variés a baissé de 66% de l’écart-type initial. Or, il faut commencer à s’inquiéter à partir de 20% et une année d’apprentissage dans des enquêtes analogues correspond à 50% de l’écart-type initial environ. Dans la période qui a suivi (1999 – 2007) les performances ont encore baissé mais de manière non significative.
Cette étude est d’ailleurs l’une de celles qui ont conduit Antoine Prost que l’on ne peut guère soupçonner de « school bashing », à écrire : « Le niveau scolaire baisse, cette fois-ci c’est vrai »[iii] et à poursuivre : « C’est aux professeurs des écoles et à leurs inspecteurs qu’il revient d’y réfléchir collectivement. Et le temps presse : nous avons un vrai problème de pédagogie qui ne se résoudra pas en un jour. »
On peut considérer que leur réaction est tardive : c’est en 2007 que sont parues les premières analyses commençant à étayer l’idée que la succession temporelle entre la réhabilitation du comptage-numérotage et la forte dégradation constatée n’est pas fortuite[iv]. Et les publications étayant de mieux de mieux cette thèse se sont succédé, faisant suite respectivement à des communications scientifiques à la conférence nationale sur l’enseignement des mathématiques de Lyon (2012)[v], au séminaire des Archives Piaget à Genève (2013)[vi], au séminaire national de didactique des mathématiques de mars 2013 à Paris[vii] et aux journées nationales de l’IFE sur l’enseignement des mathématiques à Lyon en juin 2013.
Le texte du 10 juin dernier est le premier dans lequel ils tentent de débattre de ces analyses. Nous allons voir qu’ils le font maladroitement et de manière peu convaincante. Pourquoi ce texte maintenant ? On peut penser que le silence aurait perduré si « l’air du temps » n’annonçait une prise en compte de ces analyses dans les futurs programmes. Donnons un exemple : la DEPP organise « Les jeudi de la DEPP » qui sont des réunions-débats autour de ses recherches. La dernière rencontre de ce type avait comme thème la recherche CP – CE2 qui vient d’être publiée. Viviane Bouysse, inspectrice générale qui était maîtresse de CP au début de sa carrière, a publiquement exprimé le doute suivant : à son époque les apprentissages que permet une file des écritures chiffrées étaient des apprentissages sociaux incidents, que faut-il penser de la « didactification » de cet outil qui a conduit à le placer au cœur de la plupart des activités numériques à l’école maternelle et au cycle 2 ? On retrouve d’ailleurs une interrogation du même type dans le rapport sur l’école maternelle qu’elle a rédigé avec le doyen de l’Inspection Générale : « les apprentissages « culturels » que symbolise l’omniprésence de la suite numérique ont pris le pas sur le traitement des quantités et la relation entre nombre et quantité »[viii].
Les défenseurs des programmes de 2002 ont intitulé leur texte : « Pour une réflexion sereine sur les résultats en mathématiques de l’évaluation en début de CE2 ». C’est donc en partant de cette étude qu’il sera le plus facile d’analyser leur point de vue.
Les défenseurs des programmes de 2002 restent aveugles aux enseignements de l’étude CP–CE2 de la DEPP
Le titre du texte des défenseurs des programmes de 2002 parle de l’étude récente de la DEPP[ix] mais sans parler du CP. En fait, leur texte non plus n’en parle pas. Ils l’ont rédigé comme si l’étude de la DEPP n’avait pas consisté en un suivi de deux générations d’élèves à deux moments de leur parcours scolaires : l’entrée au CP et l’entrée au CE2. Ils font comme si cette étude avait seulement visé à apprécier comment le niveau des élèves à l’entrée au CE2 a évolué (il est globalement stable). À aucun moment dans leur texte, ils ne rapportent le fait qu’en septembre dernier, la DEPP avait publié une première note intitulée : « Forte augmentation du niveau des acquis des élèves à l’entrée au CP entre 1997 et 2011 » et que la presse nationale en avait largement rendu compte. Est-il possible de le dire : les défenseurs des programmes de 2002 ont mal compris ce qu’il importe d’expliquer dans les résultats qui viennent d’être publiés : alors que la génération des élèves qui sont rentrés au CP en 2011 surclassait leurs congénères de 1997, on ne trouve plus trace de ces progrès deux ans plus tard, à leur entrée en CE2. C’est un phénomène surprenant qu’il convient d’expliquer.
Et cela d’autant plus que cette étude n’est pas la première étude à mettre en évidence un tel phénomène. Dans celle de Thierry Rocher (2008), les élèves qui étaient en CM2 en 1987, ceux qui calculaient encore bien, avaient fréquenté une école maternelle très influencée par la théorie du grand psychologue genevois Jean Piaget (en gros : la période 1970–1986). Celui-ci pensait qu’avant 6 ans les enfants ne peuvent pas comprendre les nombres. Lors d’un colloque de l’AGEEM, une directrice d’école maternelle l’interrogeait ainsi : « Monsieur le Professeur, vous nous dites qu’avant 6 ans l’enfant n’est pas conservant. Mais nous, que faisons-nous avec les élèves qui nous sont confiés ? » Et lui de répondre : « Vous savez, l’important est peut-être de ne pas commencer trop tôt ». À cette époque, les enseignants de maternelle avaient élaboré tout un ensemble d’activités qu’ils qualifiaient de « pré-numériques » et dont il était raisonnable de penser qu’elles préparaient à l’entrée dans le nombre. Inutile de dire qu’aucune classe maternelle n’avait de file numérotée affichée sur le mur. Dans les fichiers de CP les plus utilisés à l’époque, le « Eiler » et le « Thévenet », la leçon sur les nombres 1, 2 et 3 venait en novembre au CP et les élèves découvraient l’écriture « 10 » en janvier au CP.
Or, ce sont ces élèves, commençant très tardivement leurs apprentissages numériques, qui, arrivés en CM2, avaient environ un an d’avance en calcul sur ceux d’aujourd’hui. Comment pourrait-on ne pas s’interroger sur la pertinence de la façon dont les élèves apprennent les nombres aujourd’hui : ils apprennent à compter dès la PS de maternelle, ils voient quotidiennement une file numérotée jusqu’à 30 affichée sur le mur de leur classe dès cette petite classe et, sur le long terme, non seulement les « progrès » qui s’ensuivent ne se trouvent pas confirmés mais ils se transforment en un retard très important.
Concernant l’étude CP–CE1, les défenseurs des programmes de 2002 écrivent : « En chœur, la presse s’est fait l’écho d’une baisse de niveau en CE2 là où la note évoque seulement des performances globales en baisse ». Leur propos est donc sur le mode du reproche : encore une fois les journalistes dans leur ensemble auraient participé à une sorte de « school bashing ».
Les journalistes ont interrogé de manière prioritaire Catherine Moisan, la directrice de la DEPP et Michel Fayol, membre de la commission maternelle du CSP, qui, tous deux, avaient été chargés de la communication institutionnelle concernant les résultats de l’étude CP – CE1. Or, lorsqu’on relit ou réécoute les interviews que les journalistes ont faites, on s’aperçoit qu’ils posent les bonnes questions.
C’est par exemple Louise Tourret qui, dans l’émission Rue des écoles[x] invite d’emblée Catherine Moisan à mettre en relation les résultats à l’entrée au CP et à l’entrée au CE2. La directrice de la DEPP insiste sur le contraste entre les progrès « considérables », « extraordinaires » observés à l’entrée au CP et la stagnation globale au CE2. Pour l’expliquer, elle évoque chez les élèves un défaut de « conscience des nombres ». C’est aussi François Jarraud qui pose à Michel Fayol la question[xi] : « L’étude de la Depp montre que si des progrès ont été faits pour l’apprentissage du dénombrement en CP, la maitrise du nombre n’a pas progressé en CE2. Comment l’expliquez-vous ? » Michel Fayol lui répond : « L’amélioration observée en CP ne porte que sur certaines habiletés. Ce qui est évalué en CE2 est éloigné de ces habiletés. Certaines méthodes de CP sont à risque ».
Les journalistes, contrairement aux défenseurs des programmes de 2002, ont donc perçu ce qui est essentiel dans l’étude CP – CE2. Par ailleurs, les réponses de Catherine Moisan et Michel Fayol aiguisent la curiosité : qu’est-ce que cette « conscience des nombres » qui ferait défaut aux élèves ? Quelles sont ces méthodes de CP qui seraient à risque ?
Nombres conscients et nombres moins conscients, nombres vivants et nombres morts, nombres et quantités
Dans les années 1880, Ferdinand Buisson considérait que comprendre un nombre c’est « pouvoir le comparer avec d’autres, le suivre dans ses transformations, le saisir et le mesurer, le composer et le décomposer à volonté ». Lorsqu’on met ainsi l’accent sur les décompositions, comprendre le nombre 8, par exemple, c’est s’être forgé la conviction que pour construire une collection de 8 unités, on peut en ajouter 1 à une collection de 7, on peut en ajouter 3 à une collection de 5, on peut réunir deux collections de 4, on peut enlever 2 à une collection de 10, etc. Et plus tard dans la scolarité, c’est savoir que 200 est égal à 8 fois 25, que 1000 est égal à 8 fois 125… Comprendre un nombre, c’est savoir comment on peut le former à l’aide de nombres plus petits que lui et c’est savoir l’utiliser pour en créer de plus grands. Rappelons que Ferdinand Buisson fut le directeur de l’enseignement primaire de Jules Ferry, dirigea le célèbre Dictionnaire de Pédagogie et d’Instruction primaire et occupa une chaire de Pédagogie à la Sorbonne. Il fut donc le pédagogue le plus influent lors de la création de l’école de la République.
Cette définition du nombre a été reprise par les pédagogues qui, à la Libération, s’inscrivaient dans le mouvement de l’éducation Nouvelle : Henri Canac, Gaston Mialaret, etc. Ils y ont ajouté la préconisation suivante : le plus sûr moyen de s’assurer que les élèves s’approprient les décompositions des nombres est de les aborder de manière progressive : les 5 premiers nombres d’abord, puis les nombres jusqu’à 10 et seulement ensuite les nombres 11, 12, 13… Et lors de leur première rencontre à l’école avec les nombres plus grands que 10, les élèves découvraient que 11 = 10 + 1, 12 = 10 + 2, 13 = 10 + 3, etc. Les nombres au-delà de 10 étaient définis de cette manière, dans le même temps que leur écriture était explicitée à l’aide de la dizaine. De plus, ces pédagogues préconisaient un emploi systématique des stratégies de calcul où l’on s’appuie sur la dizaine pour déterminer le résultat d’additions et de soustractions élémentaires : 8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 10 + 4, par exemple. Ils apprenaient de même que 18 + 6 = 18 + 2 + 4 = 20 + 4, que 28 + 6 = 28 + 2 + 4 = 30 + 4, etc.
Tout laisse à penser que Catherine Moisan appelle « nombres conscients » des nombres définis au sens de Buisson et Canac. Il est intéressant de noter qu’un autre mathématicien, Pierre Arnoux appelle « nombres vivants » des nombres qui fonctionnent ainsi dans la tête des enfants ou des étudiants[xii]. Dans un écrit préparatoire à la conférence nationale sur l’enseignement des mathématiques de Lyon en 2012, il définit les nombres vivants comme ceux « qui sont en relation avec d’autres nombres et d’autres concepts, et qui sont le point de départ spontané de divers processus mentaux. ».
Mais alors que sont les nombres morts ou inertes ou bien encore les nombres non-conscients ou moins conscients ? Ils correspondent à un usage « performant » du comptage-numérotage. Ainsi, depuis 30 ans environ, les étudiants des écoles normales, des IUFM puis des ESPE apprennent que les élèves doivent développer des connaissances leur permettant de garder la mémoire des quantités. La situation pédagogique recommandée à cet effet est celle où l’élève est devant une collection de coquetiers et où l’enseignant lui demande d’aller chercher à l’autre bout de la classe, en un seul voyage, une collection d’œufs qui conduise à mettre exactement un œuf dans chaque coquetier. Or, pour réussir ce problème, il suffit de compter-numéroter les coquetiers (le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, par exemple) et de compter-numéroter « pareil » les œufs, il n’est pas nécessaire de savoir comment le nombre 8 s’exprime en nombres plus petits que lui. Pour garder la mémoire d’une quantité, l’usage de numéros ou encore de nombres morts, non conscients, suffit.
Mais alors, comment s’exprimer ? Les qualificatifs de « vivants » et « conscients » évoquent bien la notion de nombre au sens de Buisson et Canac et leurs antonymes « morts » ou « inertes » et « non conscient » le type de représentation mentale auquel le comptage-numérotage permet d’accéder. Mais il faut reconnaître que ce vocabulaire imagé rejoint en fait l’opposition entre deux concepts classiques : « quantité » et « nombre ». Un comptage-numérotage « performant » permet de représenter la quantité, pas nécessairement le nombre. Pour accéder au nombre, il faut construire un réseau de relations cardinales qui n’est pas en jeu dans la notion de quantité.
En fait, pour bien comprendre la différence entre quantité et nombre, il faut distinguer chacune de ces notions d’une autre, celle de grandeur.
Grandeurs, quantités et nombres
Il est important de distinguer les grandeurs et les quantités. En effet, le sens des grandeurs est inné chez la plupart des oiseaux et des mammifères. Dès que la différence entre deux tas de bananes est suffisante, tous les primates savent déterminer le plus grand, par exemple. Aucun élève, sauf grave pathologie, n’est en difficulté parce qu’il n’accèderait pas au sens des grandeurs.
Le comptage-numérotage est l’un des moyens qui, à partir du sens inné des grandeurs, permet d’accéder aux quantités. En effet, l’enfant comprend assez facilement que, lorsqu’il compte : « le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 », par exemple, c’est « plus grand » que « le 1, le 2, le 3, le 4 ». Il comprend que lorsqu’il est conduit à compter-numéroter plus loin et plus longtemps, c’est « plus grand ».
Or, au sens classique du mot « quantité », l’enfant accède aux quantités discrètes en mettant en relation son sens inné des grandeurs (il y a globalement plus ici que là) avec une procédure qui explicite chaque unité de manière compatible cet ordre inné (Cf. le vocabulaire technique de philosophie de Lalande, par exemple).
Cependant, lorsqu’un enfant accède ainsi aux quantités, à partir d’un comptage-numérotage, c’est en s’appuyant sur la signification « numéro » des mots-nombres qu’il apprécie s’il compte plus ou moins longtemps / loin. C’est la signification « numéro » qui donne du sens à cette procédure et c’est celle sur laquelle les enfants vont s’appuyer de manière privilégiée. Cela explique qu’ils accèderont ainsi aux quantités mais pas nécessairement aux nombres qui, eux, exigent un usage cardinal des mots-nombres : six, c’est quatre et encore deux.
Une autre manière d’expliciter la différence entre grandeur, quantité et nombre est de s’intéresser aux deux sortes d’élèves en difficulté à l’école maternelle lorsque les professeurs des écoles choisissent d’enseigner le comptage-numérotage précocement. Dans ce cas, tous les chercheurs (Karen Fuson, Karen Wynn, Susan Carey, Stanislas Dehaene, etc.) s’accordent pour dire que les enfants rentrent d’abord dans une mécanique sans signification. L’évolution se fait généralement ainsi :
1°) Il y a les élèves qui ne mettent pas en relation leur comptage-numérotage avec leur sens inné des grandeurs. Ceux-là restent longtemps enfermés dans un comptage mécanique, ils n’accèdent pas aux quantités. Mais cela ne dure pas toute leur scolarité. À terme, ils entrent dans la deuxième sorte d’élèves en difficulté.
2°) Il y a ceux qui mettent en relation leur comptage-numérotage avec leur sens inné des grandeurs, qui réussissent progressivement toutes les tâches impliquant des quantités mais sans construire un réseau de relations cardinales. Ils ne construisent pas ces relations parce qu’ils ont besoin de s’appuyer sur des numéros pour donner du sens à ce qu’ils font. Ils n’accèdent pas aux nombres au sens de Buisson et Canac, ils restent enfermés dans un comptage-numérotage « performant ».
Toutes les études sur la grande difficulté persistante en mathématiques (travaux de Geary, synthèse de l’INSERM, etc.) montrent que les élèves concernés sont du deuxième type.
Les défenseurs des programmes de 2002 restent aveugles au principal danger d’un enseignement du comptage-numérotage
Dans leur texte, les défenseurs des programmes de 2002 mettent fortement en avant une approche fonctionnelle des apprentissages numériques qui, en soi, est très intéressante et qui était l’une des principales caractéristiques de ces programmes : « Dans de nombreuses classes d’école maternelle les enseignants proposent des situations dans lesquelles les élèves, petit à petit, vont être confrontés à différentes fonctions du nombre et être conduits à élaborer des moyens oraux et écrits, certes primitifs, pour garder en mémoire des informations numériques ».
La mise en gras du mot « primitif » est de notre fait parce qu’à lui seul il explique l’échec du projet didactique et pédagogique correspondant : le comptage-numérotage est un moyen primitif de résoudre l’ensemble des problèmes correspondant aux différentes fonctions du nombre mais sans utiliser les nombres, en traitant seulement les quantités : garder la mémoire d’une quantité, comparer deux quantités, les égaliser, mesurer une quantité résultant d’un ajout ou d’un retrait, chercher un complément, etc.
Nous l’avons vu concernant le problème nécessitant de garder la mémoire d’une quantité (coquetiers et œufs). Nul besoin de connaître des relations entre les nombres pour réussir. La représentation des quantités n’est pas numérique au sens de Buisson et Canac, mais elle est fonctionnelle. La principale difficulté qui surgit lorsque l’école valorise cette sorte de stratégie plutôt que de valoriser d’emblée les stratégies numériques, est que les élèves les plus fragiles s’enferment dans leur emploi.
C’est le cas par exemple de cet élève à qui il est proposé le problème suivant (évaluation de fin de CE1) : « à la récréation, Dimitri joue aux billes. Au début de la partie il possède 37 billes. À la fin, il a 72 billes. Combien a-t-il gagné de billes ? ». Il le résout ainsi :
Examiné sous l’angle théorique, il apparaît que ce type de résolution se fonde sur un usage des numéros comme s’il s’agissait d’objets. Malheureusement, lorsque l’usage de ce type d’objets construits mentalement est installé, il est extrêmement difficile au pédagogue de favoriser l’accès à un niveau supérieur de résolution, celui d’une résolution arithmétique où l’enfant utilise la soustraction. D’ailleurs, les enseignants s’accordent sur le fait que lorsqu’un enfant résout ainsi un problème, l’abandon de ce type de résolution est difficile. Les élèves les plus fragiles ne l’abandonnent que pour choisir une opération à partir d’un « mot-clé » de l’énoncé (ici le mot « gagne » induira vraisemblablement l’addition) ou un autre indice non pertinent (l’opération en cours d’étude, par exemple).
Lorsque, chaque année, je demande à mes étudiants stagiaires F qui se forment pour enseigner en SEGPA, d’enquêter dans leur classe pour savoir comment leurs élèves déterminent 8 + 6, ils observent régulièrement que les trois quarts de leurs élèves environ n’ont pas d’autre moyen pour accéder au résultat de 8 + 6 que d’utiliser un comptage-numérotage au-dessus de 8 avec leurs doigts. Rappelons que Henri Canac disait de ces élèves qu’ils avaient été « mal débutés ».
Les défenseurs des programmes de 2002 soulignent dans leur texte que l’enseignement du comptage-numérotage risque de conduire dans un premier temps à un comptage mécanique. Ils ont raison et on peut même aller plus loin : cet enseignement conduit systématiquement à un comptage mécanique si les enfants n’ont pas déjà construit un petit système numérique des 3 – 4 premiers nombres au sens de Buisson et Canac.
Mais ils restent aveugles au principal danger d’un enseignement du comptage-numérotage : cet enseignement est surtout dangereux du fait qu’il permet de réussir (au sens de l’obtention du « bon résultat ») pratiquement tous les problèmes utilisés à l’école, du moins ceux qui mettent en jeu les différentes fonctions du nombre, il est dangereux parce qu’il permet aux élèves d’accéder à la solution en traitant seulement les quantités, pas les nombres. Ne serait-ce pas ce que Michel Fayol appelle dans son interview au Café Pédagogique une « progression à risque » ?
Cela fonctionne d’autant plus comme une sorte de piège que l’enseignement du comptage-numérotage met des « succès pédagogiques » faciles à portée de main des enseignants : ils peuvent apprendre à leurs élèves à compter loin, à produire loin les écritures chiffrées, etc. Persuader un enseignant que dans l’intérêt de ses élèves il doit se priver de ces succès pédagogiques faciles ne sera pas une mince affaire.
Ce cadre théorique se trouve en tout cas confirmé à la fois par l’étude de Thierry Rocher en 2008 et par la récente étude CP – CE1 de la DEPP. Depuis 1986, en effet, notre système scolaire favorise ce type de progression et les résultats sont conformes à ce qui vient d’être dit : on a l’impression de meilleures réussites dans les petites classes, mais celles-ci se transforment sur le long terme en stagnation voire en retard très important.
Pour des programmes consensuels et des documents d’accompagnement qui expliquent les implicites des programmes
L’une des grandes psychologues du nombre à l’école, Karen Fuson, après avoir étudié pendant près de quinze ans comment les enfants états-uniens découvrent de nouvelles stratégies de comptage pour résoudre des problèmes d’addition et de soustraction, a observé chez des enfants coréens un cheminement très différent, fondé sur l’usage de stratégies de décomposition-recomposition. Or, ce cheminement s’avère autrement plus rapide : les enfants asiatiques ont, pour l’essentiel, mémorisé les résultats des additions élémentaires en fin de CP ; les enfants vivant aux États-Unis, un an et demi à deux ans plus tard. Karen Fuson[xiii] écrit en 1992 : « Les stratégies utilisées par les enfants trouvent toujours leur origine dans des pratiques culturelles, qu’elles soient propres au contexte scolaire ou qu’elles proviennent de l’environnement social plus global de l’enfant ; ces stratégies ne surgissent pas d’un vide culturel ou expérientiel. Il est très important que nous nous interrogions sur les méthodes qu’il convient de favoriser plutôt que d’accepter systématiquement celles qui sont découvertes par les enfants parce qu’elles seraient naturelles ».
Dans un chapitre d’un ouvrage intitulé « Les chemins du nombre »[xiv] publié simultanément en France et aux USA en 1992, je m’appuyais sur une étude ancienne de Descoeudres (1921) pour montrer qu’il est possible de favoriser d’emblée l’usage de stratégies de décomposition-recomposition à l’école, dès la PS. Cette chercheuse avait étudié la capacité des enfants à montrer autant de doigts qu’il y a d’objets dans une collection donnée. Elle avait fait une description détaillée du comportement d’un enfant à la suite de cette épreuve :
« Un jour, j’avais commencé la série des tests de calcul avec un petit garçon intelligent, de quatre ans quatre mois ; le lendemain, il vint chez moi pour les terminer ; entre-temps, pour éviter la fatigue, il jouait avec des plots. Spontanément, il se mit à employer le procédé des doigts pour dénombrer ses plots ; comme langage, il ne possédait que les noms des deux premiers nombres. G. a trois plots devant lui et raconte, en montrant trois doigts : “Ça c’est plus que deux, c’est comme ça” ;… »
À son âge, l’enfant G. ne connaît pas encore le mot trois (cette étude est ancienne et on peut penser que ce petit garçon « intelligent » n’avait eu que peu d’occasions de dialoguer avec autrui à propos de nombres), mais il importe de remarquer qu’il met spontanément en œuvre une stratégie de décomposition-recomposition où le nombre trois est décrit sous la forme : deux et encore un. Détaillons ce processus : ayant 3 objets sous les yeux, G. dit : « Ça, c’est plus que deux ». Il a donc reconnu deux dans la totalité des plots : ayant reconnu 2 dans 3, il a procédé à une décomposition de la totalité. L’enfant exprime ensuite le nombre : il dit « c’est comme ça » en montrant trois doigts. Ce faisant, il a levé un doigt de plus que s’il en avait montré deux, il a donc exprimé trois à l’aide de la décomposition-recomposition : deux et encore un.
Au début des années 1990, dans une série d’articles publiés dans la revue Grand N[xv] et dans Repères[xvi], j’ai essayé de convaincre Roland Charnay[xvii], l’un des signataires du texte, du fait qu’il convient délibérément de privilégier ces stratégies de décomposition-recomposition afin de définir 3 comme « 1, 1 et encore 1 » ou bien « 2 et encore 1 ». Et de continuer ainsi en définissant 4 comme « 3 et encore 1 » ou bien « 2 et encore 2 ». Aujourd’hui, à lire le texte rédigé par les défenseurs des programmes de 2002, ils semblent favorables à cette démarche. C’est un élément extrêmement positif parce que cela facilitera la rédaction de programmes consensuels pour la petite et la moyenne section.
Concernant la GS, il me semble que les arguments qui étayent le lien entre comptage-numérotage et échec à long terme en calcul sont suffisamment forts pour que les programmes autorisent les enseignants qui le souhaitent à renouer avec la culture pédagogique qui était la nôtre avant 1986. Les programmes de 2008, en exigeant des enseignants qu’ils apprennent à leurs élèves à lire et écrire les numéros jusqu’à 30, ne l’autorisaient pas. Il faut aujourd’hui redonner aux enseignants de maternelle la liberté de n’enseigner que les 10 premiers nombres plutôt que les 30 premiers numéros. Techniquement, c’est possible. Il suffit que les programmes pour la maternelle spécifie que rien n’est exigé concernant les nombres supérieurs à 10. Ne pas exiger, ce n’est pas interdire et les enseignants qui le souhaitent pourront continuer à enseigner le comptage-numérotage jusqu’à 30.
Bien entendu, cela crée de l’implicite dans les programmes et il est donc absolument nécessaire que des documents d’accompagnement explicitent les raisons de cette possibilité nouvelle, les défenseurs de l’enseignement du comptage-numérotage explicitant leurs arguments, ceux de l’enseignement des décompositions des premiers nombres les leurs. Au sein des écoles, des circonscriptions, dans les ESPE, il y aura là un beau sujet de débat professionnel et l’on peut espérer qu’à l’avenir les enseignants auront la possibilité d’exercer leur liberté pédagogique avec la responsabilité résultant d’une bonne réflexion sur cette question.
Rappelons-nous ce que recommandait Antoine Prost : « C’est aux professeurs des écoles et à leurs inspecteurs qu’il revient d’y réfléchir collectivement. Et le temps presse : nous avons un vrai problème de pédagogie qui ne se résoudra pas en un jour. » Or, il ne suffit pas de réunir des enseignants dans une même salle pour que le débat professionnel s’engage : ce n’est possible que lorsqu’une problématique a déjà été dégagée, une liste d’arguments à envisager commencée…
Il n’y a pas qu’une façon de renouer avec la culture pédagogique d’avant 1986
Dans leur texte, les défenseurs des programmes de 2002 écrivent :
« Faut-il simplement revenir au programme de 1945 à partir duquel un enseignement souvent répétitif des nombres, l’un après l’autre, était proposé ? Sans doute pas, car cela reviendrait précisément à faire fi des avancées dans différents domaines de recherche (didactique, psychologie, sciences de l’éducation, neuropsychologie…), et à considérer que les changements sociétaux très importants depuis cette époque n’ont aucune incidence sur l’enseignement des mathématiques. »
Ainsi, les défenseurs des programmes de 2002 agitent une sorte d’épouvantail : la seule façon de renouer avec la culture pédagogique d’avant 1986 consisterait en un retour aux pratiques pédagogiques d’avant la réforme des mathématiques modernes. D’abord, il n’est pas sûr que les pratiques pédagogiques du temps où le mouvement de l’Éducation Nouvelle était à son apogée, soient l’épouvantail qu’ils agitent.
Ensuite, on dispose de divers exemples montrant qu’il est possible de privilégier systématiquement l’usage de stratégies de décomposition-recomposition en adoptant une pédagogie de type fonctionnelle ou constructiviste. Guy Brousseau, l’un des plus grands didacticiens des mathématiques, avait proposé une approche de ce type au CP dans les années 1970, la progression correspondante est connue en tant que « démarche des boîtes-nombres ». Un didacticien de Créteil, éric Mounier, expérimente actuellement une approche de ce type pour enseigner la numération au CP. La problématique de l’accès à des décompositions-recompositions variées est également au cœur de l’approche de la numération au CE1 et au CE2 de Frédérick Tempier[xviii]. Dans les outils pédagogiques que j’ai élaborés, les enfants sont invités à simuler mentalement des stratégies de décomposition-recomposition que l’enseignant réalise effectivement mais de manière masquée. Il s’agit d’anticiper le résultat d’un ajout, d’un retrait, d’une comparaison… Là encore, il s’agit d’une démarche fonctionnelle.
Par ailleurs, une recherche est actuellement en cours, associant des collègues psychologues (Jean-Paul Fischer, Emmanuel Sander, Bruno Vilette) et un didacticien (Gérard Sensevy). Maryline Baumard[xix] en parle dans son dernier livre et il semble bien qu’ils adoptent une progression privilégiant les stratégies de décompositions-recompositions, que leur approche est basée sur la méfiance vis-à-vis du comptage-numérotage.
Concluons en remarquant que renouer avec la culture pédagogique d’avant 1986, ce n’est pas faire fi des avancées dans différents domaines de recherche. Concernant les psychologues développementalistes, par exemple, il a été montré[xx] que l’évolution dans la façon dont ils définissent la compréhension des nombres, depuis Rochel Gelman en passant par Karen Wynn, Susan Carey, Kathryn Davidson et enfin Arthur Baroody, s’est progressivement rapprochée de celle de Buisson et Canac. Si les défenseurs des programmes de 2002 pensent pouvoir soutenir une analyse contraire, il faut qu’ils le fassent. Sinon, il faut considérer que renouer avec la culture pédagogique qui était la nôtre avant 1986, c’est tout au contraire prendre en compte les avancées les plus récentes de la recherche.
Rémi Brissiaud
Laboratoire Paragraphe – Université Paris 8
[ii] Rocher T. (2008) Lire, écrire, compter : les performances des élèves de CM2 à vingt ans d’intervalle 1987-2007. Note 08.38 de la DEPP ; décembre 2008.
[iv] Brissiaud, R. (2007) Premiers pas vers les maths. Les chemins de la réussite à l’école maternelle. Paris : Retz.
[vii] Brissiaud, R. (2014) L’effondrement des performances en calcul entre 1987 et 1999 : quelle épidémiologie ? In Sylvie Coppé & Maria Haspekian (Eds) : acte du séminaire national de didactique 2013
[xiii] Fuson K.C. & Kwon Y. (1992) : Korean children’s single-digit addition and substraction: numbers structured by ten. Journal for Research in Mathematics Education, 23 (2), 148-165.
[xiv] Brissiaud, R. (1991). « Un outil pour construire le nombre : les collections-témoins de doigts », in J. Bideaud, C. Meljac & J.-P. Fischer (éd.), Les chemins du nombre, p. 59-90. Lille : Presses universitaires.
[xv] Brissiaud R. (1991) Calculer et compter de la PS à la GS de maternelle. Revue Grand N, 49, p. 37-48
[xvi] Brissiaud, R. (1995) Le comptage en tant que pratique verbale : un rôle ambivalent dans le progrès des enfants. Repères, 12, p. 120-143.
[xvii] Charnay, R. & Valentin, D. (1991) Calcul ou comptage ? Calcul et comptage ! Revue Grand N, 50, p. 11-20
[xviii] Tempier Frédérick (2013) La numération décimale de position à l’école primaire. Une ingénierie didactique pour le développement d’une ressource. Thèse Université Paris 7.
[xix] Baumard, M. (2013) La France enfin première de la classe. Paris : Fayard.
[xx] Brissiaud, R. (2013) Apprendre à calculer à l’école – Les pièges à éviter en contexte francophone. Paris : Retz
Cet ouvrage a pour l’essentiel été mis en ligne sur le Café Pédagogique en 3 textes successifs :
Il faut refonder l’apprentissage 1
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/11/12112012Arti[…]
Il faut refonder l’apprentissage 2
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/11/13112012Arti[…]
Il faut refonder l’apprentissage 3
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/11/14112012Arti[…]





